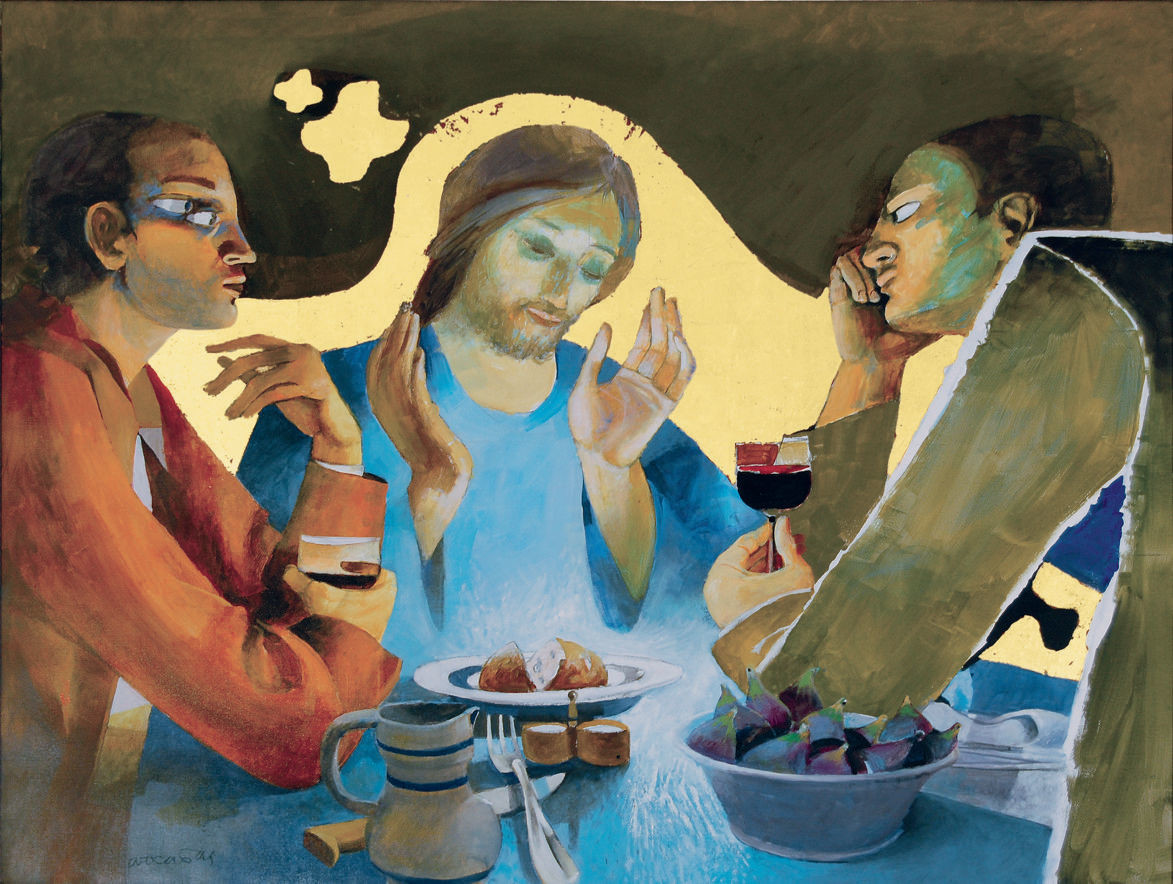L’après-midi du samedi 20 octobre, les trois pères dominicains Jean-Michel Maldamé, Serge-Thomas Bonino et Benoît-Dominique de la Soujeole, ont donné une leçon publique à l’occasion de la réception du grade de « maîtres en sacrée théologie » au couvent des dominicains de Toulouse. Ayant eu la chance d’avoir eu les deux premiers comme professeurs à la Catho de Toulouse, je vous transmets ci-dessous les notes que j’ai été heureux de prendre à ces conférences – ces notes n’engagent pas les conférenciers, car j’ai pu mal entendre ou mal interpréter. Elles portaient sur :
L’après-midi du samedi 20 octobre, les trois pères dominicains Jean-Michel Maldamé, Serge-Thomas Bonino et Benoît-Dominique de la Soujeole, ont donné une leçon publique à l’occasion de la réception du grade de « maîtres en sacrée théologie » au couvent des dominicains de Toulouse. Ayant eu la chance d’avoir eu les deux premiers comme professeurs à la Catho de Toulouse, je vous transmets ci-dessous les notes que j’ai été heureux de prendre à ces conférences – ces notes n’engagent pas les conférenciers, car j’ai pu mal entendre ou mal interpréter. Elles portaient sur :
– les premiers mots de la Bible (J.M.Maldamé)
– être un « défenseur de la foi » (S.Th.Bonino)
– la possibilité d’une concélébration eucharistique entre catholiques et orthodoxes (B.D.de la Soujeole)
Les conférences elles-mêmes peuvent être écoutées directement sur le site des dominicains : ICI.
Les premiers mots de la Bible
 Commençons par le commencement : Bereshit bara Elohim et hashamaïm vehet haarets. Cette phrase forme un tout, avec un sujet, Dieu ; un verbe, créer ; un objet, la totalité ;mais aussi un premier mot : Bereshit. Comment le traduire ? Tous s’accordent pour dire qu’il est formé à partir du mot rosh, tête, et Chouraqui traduit sans traduire par « en tête ». Les traductions habituelles des bibles BJ, TOB traduisent par « au commencement ». C’est exact, mais insuffisant. La LXX traduit par en archè, la vulgate in principium, et là, c’est plus que le commencement. C’est considérable : les 5 premiers mots forment un porche d’entrée au récit, sans faire partie du récit (La terre était informe et vide, et l’esprit planait sur les eaux…). C’est un porche pour la Genèse, mais aussi pour toute la Bible, NT compris. C’est cette exigence qui invite à voir dans Bereshit autre chose qu’un banal « au commencement ». C’est ce mot qui a inspiré Saint Jean dans le Prologue, reprenant le premier mot de la Bible grecque, et saint Paul dans son hymne du 1er chapître de l’épître aux Colossiens, auquel sera consacrée cette leçon.
Commençons par le commencement : Bereshit bara Elohim et hashamaïm vehet haarets. Cette phrase forme un tout, avec un sujet, Dieu ; un verbe, créer ; un objet, la totalité ;mais aussi un premier mot : Bereshit. Comment le traduire ? Tous s’accordent pour dire qu’il est formé à partir du mot rosh, tête, et Chouraqui traduit sans traduire par « en tête ». Les traductions habituelles des bibles BJ, TOB traduisent par « au commencement ». C’est exact, mais insuffisant. La LXX traduit par en archè, la vulgate in principium, et là, c’est plus que le commencement. C’est considérable : les 5 premiers mots forment un porche d’entrée au récit, sans faire partie du récit (La terre était informe et vide, et l’esprit planait sur les eaux…). C’est un porche pour la Genèse, mais aussi pour toute la Bible, NT compris. C’est cette exigence qui invite à voir dans Bereshit autre chose qu’un banal « au commencement ». C’est ce mot qui a inspiré Saint Jean dans le Prologue, reprenant le premier mot de la Bible grecque, et saint Paul dans son hymne du 1er chapître de l’épître aux Colossiens, auquel sera consacrée cette leçon.
Rendons grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part, dans la lumière, à l’héritage du peuple saint.
Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé,
par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature,
car c’est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles :
tout est créé par lui et pour lui.
Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église.
Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté.
Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total.
Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui,sur la terre et dans les cieux,en faisant la paix par le sang de sa croix.
(Col 1,12-20)
Nous lisons en Col 1 une confession de foi au Christ fils de Dieu. Un hymne, oui, mais en réalité une confession. Une grande phrase, majestueuse, ample, qui couronne l’évolution de la foi de Saint Paul. La confession de l’épître aux Romains, antérieure, où Paul désigne le Christ comme Fils de David selon la chair, Fils de Dieu avec puissance, selon l’esprit de sainteté par sa résurrection d’entre les morts. (Rm 1,3). Espérance messianique, où le messie est désigné fils de Dieu par le prophète Nathan. La résurrection, est la glorification de l’humble fils de David selon la chair en Fils de Dieu. Dire que Jésus est Christ, c’est confesser l’exaltation du Christ ressuscité. Mais dans Col, Paul va plus loin: il applique à Jésus, au ressuscité, toutes les harmoniques de sens contenues dans le 1er mot de la Bible : Bereshit, en archè. Il est l’image du Dieu invisible. Paul est dans la Genèse, où l’image évoque l’homme, la seule image possible de Dieu, qui n’a pas d’autre représentation possible. Derrière image, entendons Adam, créé par Dieu. Est-ce que ce rapprochement est légitime ? Oui, car c’est un thème majeur de la pensée de Saint Paul, qui l’accompagne toute sa vie de parler du Christ en référence à Adam (1 Co : Adam et Christ, principes de vie promise à la mort ou à la vie éternelle…). En 1Co, Paul parle de l’illumination de l’Evangile de la gloire du Christ lui qui est l’image de Dieu (2 Co 4,4). Ce que signifiait prophétiquement Gn 1, se trouve accompli par Jésus-Christ quand il rentre dans sa gloire. C’est à cela que fait référence le premier né d’entre les morts.
Certes, la notion d’image a été entendue dans d’autres sens chez les Pères de l’Eglise. Mais nous acceptons de rester dans le contexte de la pensée de Saint Paul.
Paul dans Col, nous dit des perspectives cosmiques, cosmologiques, et réagit à une erreur évoquée dans d’autres textes du NT, selon laquelle Jésus ressuscité serait monté aux cieux, et serait devenue une puissance céleste parmi d’autres (puisque dans ce temps les cieux étaient divinisés) fût-ce la première. Pour dire que Jésus n’est pas un être céleste parmi d’autres, Paul se réfère à ce qu’il y avait dans la Création, qui transcende le cours du temps, en affirmant la présence dans l’intention du Fils de Dieu. Les sages d’Israël, pour dire la création, prenaient la comparaison de l’architecte avec le projet qui préexiste à l’oeuvre. Dès le principe tout est créé pour tendre vers l’image du Dieu invisible. La notion d’architecte qui préexiste à la Création, identifié à la Sagesse, se retrouve dans « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. » En relisant les textes de sagesse, on trouve la Sagesse personnifiée présidant la Création, et en Si : tout ce qui est dit de la sagesse « n’est autre que le livre de l’Alliance du Très Haut » (Si 24, 23). Chez les rabbins, les scribes, les cabbalistes qui vont durcir les choses, cette sagesse, c’est la loi, qui n’est pas supprimée mais accomplie en Christ. Ce que les sages disaient de la loi, il faut le dire du Christ. Ce qui était dit d’une lettre morte, il faut le dire d’un vivant, premier né d’entre les morts. La place centrale de celui qui est glorifié est signifiée par l’emploi du premier mot de la Bible : toute la Création se comprend dans son principe (archè). « Il est le Principe »… Il faudrait à rebours traduire Bereshit, non par « Au commencement », mais « Dans la Sagesse », ou « Avec Sagesse » ou « Par la Sagesse ». Ce serait là une nouvelle traduction, qui renverrait à la lumière qui vient du 1er mot de la Bible. Traduire Bereshit par Sagesse, libérerait nos esprits d’un certain nombre de confusions, en particulier le concordisme, où l’on ferait du big bang le point zéro du modèle cosmologique standard, alors qu’elle n’est qu’une singularité initiale. La Genèse ne nous raconte pas le commencement, mais la générosité de Dieu, la sagesse de Dieu dans son acte créateur.
Le Christ est aussi désigné comme « tête du corps » (cf. rosh), ce qui anime le corps, ce qui donne vie à tout. Quand on entre dans cette compréhension des choses, on est toujours alors hanté par la question du Mal. Pour ne rien éviter, Paul évoque alors le sang de la Croix. La grande difficulté que Paul a connue dans sa jeunesse, c’est celle d’u Messie crucifié. Or C’est ce Messie crucifié qui est la tête, ce qui était annoncé dans le 1er mot de la Bible, l’amour qui va assumer, affronter la mort.
En hébreu, il y a des modes, plutôt que des temps passé, présent, futur. Dans la 1ère phrase de la Bible, portail qui ouvre jusqu’à l’Apocalypse, on n’a pas de passé, présent, avenir. Mais le passé convient, car il dit que ce qu’il y a dans le principe, c’est ce qui se déroule dans le temps. Mais c’est aussi maintenant que Dieu crée, que dans sa sagesse il nous fait vivre, que dans le Christ ressuscité il nous donne la vie.
La foi demande à s’exprimer, elle est fortifiée par l’expression de la liturgie. A la fin du cycle liturgique, il y a une fête importante, la fête du « Christ Roi ». Le Concile Vatican II et la réforme liturgique qui l’a suivi l’a changée en fête du « Christ roi de l’univers », ce qui revient à honorer le Christ dans la profession de foi de Saint Paul en Col. Cela évite des discours nostalgiques d’ancien régime, mais cela donne à la Résurrection sa place centrale, cela aussi permet de distinguer la place du Christ et la nôtre. Le mystère pascal est le cœur de la foi, et s’exprime en divers moments liturgiques. La dimension cosmique du mystère pascal est signifié dans l’Ascension. Le temps liturgique qui s’achève est récapitulé en Christ. Ce n’est pas une évasion. Dans l’hymne de Vêpres de l’Ascension, il y a 2 versets : Culpat caro, purgat caro, regnat Deus Dei caro. La chair est le lieu du péché, la chair a été l’instrument du salut et du règne de Dieu. Dieu règne sur la chair comme principe de salut. La chair de Dieu comme principe de salut, Le Christ roi de l’univers, celui qui a notre foi.
Il faut expliquer saint Paul par saint Paul, sans s’appuyer sur Jn 1 et la théologie du logos qui s’appuie sur les 1ers mots de la Genèse En archè, cela ne doit pas faire penser à un désaccord entre Paul et Jean. Il y a en fait un accord profond entre Paul et Jean. Dans le dernier entretien de sa vie publique, Jésus déclare en Jn 12,32 « Elevé de terre, j’attirerai tout à moi », le mot signifie à la fois la croix et l’exaltation. C’est ce que disait saint Paul. Le Christ attire tout à lui. Pendant la semaine sainte, à l’office du matin et au milieu du jour, une prière d’intercession s’adresse au Christ et lui demande : « Toi qui ayant étendu tes bras sur la croix, attire à toi tous les temps, tous les mondes. »
Oui, je crois, je m’efforce d’accueillir et de vivre cette parole du Christ transmise par l’Evangile de Jean : « Elevé de terre, j’attirerai tout à moi ».
Être un défenseur de la foi
Si on laisse de côté la question pourtant essentielle de la langue, que reste-t-il comme différence entre un moudjahidine afghan et un dominicain ? Tous deux sont des combattants de la foi. Pour « la défense de la foi », dit la liturgie. Cette défense est au cœur de la vocation dominicaine. Ainsi pour la prière sur les offrandes pour la messe de Saint Thomas d’Aquin. La préface insiste : « Dominique fonda son ordre pour mener le combat de la foi. » Vocabulaire martial, voire belliqueux.
La différence tient dans la nature, les finalités, et donc le style et les moyens du combat. Le combat de la foi désigne la lutte vitale que mène chaque homme dans sa vie. Au plus intime de lui-même s’affronte la vie et la mort, la voix de la foi et les voix mauvaises de l’incrédulité, du désespoir, d’une pitoyable sagesse du carpe diem sans raison de vivre. L’homme reste un animal métaphysique, en qui a été inoculé le terrible virus métaphysique, qui fait sa souffrance et son honneur de ne plus se satisfaire du relatif. Odon Vallet signale que le simple fait de donner la vie à la génération qui vient, signifie que la vie est pour nous intrinsèquement bonne, valant la peine d’être vécue. Un oui à la vie, qui en dernière analyse est un oui à Dieu ; un oui jamais acquis, arraché à la tentation du nihilisme et de l’incroyance. Seul face au gué de Yabboq, Jacob a lutté toute la nuit et en sort vainqueur : je ne te lâcherai pas que tu m’aies béni. Combat de la foi, dans la nuit, solitaire, qui se conclue par une bénédiction. Mais cela se vit en Eglise, et les dominicains ont mission d’accompagner le combat apostolique de la foi, en vue du salut des âmes. Ce combat apostolique consiste à écarter les obstacles qui s’opposent à la rencontre personnelle avec le Christ. 2 conditions : au plan objectif, la foi fides quae désigne un enseignement qui s’adresse à l’intelligence pour ouvrir un nouvel horizon pour l’existence ; le combat pour la foi implique de proposer un enseignement vrai. Mais il faut aussi la fides qua, au plan subjectif : les conditions favorables à l’accueil de la foi.
Le 1er obstacle, c’est l’erreur sur la personne, comme Jacob qui se trompe entre Rachel et Léa – de l’inconvénient du voile intégral… Il faut pour cela que la Parole de Dieu soit donnée elle-même, et non nos accommodements idéologies, nos hérésies, une sorte de Canada Dry, qui ressemble à la foi, en a le goût, mais n’est pas la foi. Pour que ce soit bien cette parole qui soit transmise, Jésus a promis l’assistance de l’Esprit Saint pour la transmission de cette parole. L’Eglise veille à transmettre sans altération ce qu’elle a reçu du Christ. Cette mission est celle de toute l’Eglise. Mais l’Eglise n’est pas un tout indifférencié, mais structuré. Tous les chrétiens sont dotés d’un flair, d’un 6ème sens, le sensus fidei qui leur permet de sentir la conformité de l’enseignement avec la foi reçue des apôtres. Mais les pasteurs, les évêques ont reçu un charisme pour prêcher la foi en étant attentif à écarter toutes les erreurs qui menacent le troupeau. Cf. l’iconographie qui représente Saint Thomas d’Aquin avec sur la poitrine un soleil qui dissipe les ténèbres de l’erreur par la vérité de son enseignement. Il revient à une seule et même personne de s’attacher à un contraire et à réfuter l’autre. L’office du sage est de méditer la vérité et de combattre les erreurs. L’erreur, de manière générale est un mal qui blesse la personne dans sa capacité à connaître, qui est la condition d’un agir responsable. Elle limite la liberté, et empêche de prendre de bonnes décisions. Combattre l’erreur est un service rendu au croyant. Il faut veiller qu’aux enfants qui demandent du pain, on ne remette pas une pierre. Le catéchisme de l’Eglise indique que la mission du Magistère est d’écarter les erreurs pour permettre de professer la foi authentique. Les frères dominicains, en vertu de leur profession participent à cette mission. 1215 : ordination des premiers frères pour être prédicateurs, chargé d’extirper les erreurs, chasser le vice… avec les termes mêmes du Concile de Latran IV pour définir le munus docendi des évêques. Participation à la mission enseignante des évêques. Cela inclue la défense et illustration de la foi catholique. L’assistance promise à l’Eglise n’est pas magique, extrinsèque, elle ne tombe pas du ciel, mais s’inscrit dans une démarche ecclésiale, avec les moyens humains pour accomplir cette tâche. L’étude est le 1er moyen, consubstantiel à la vocation dominicaine, par une immersion dans la Parole de Dieu, qui fait discerner ce qui est conforme ou non à la foi apostolique. Mais cette étude qui met en œuvre les ressources de la rationalité est aussi une affaire spirituelle. Le théologien doit dans la prière garder un contact vivant avec la Révélation, avec une nécessaire purification de son intention profonde, car la défense de la vérité est un lieu propice à la volonté de toute puissance, avec le désir d’avoir toujours raison, qui remplace l’effacement humble devant la vérité. Cette humilité fait du théologien le collaborateur de la vérité. Son obéissance permettra que la vérité puisse parler à travers la théologie.
L’agronome ne veille pas à la qualité des semences pour les conserver sous cloche. De même, l’Eglise conserve le dépôt de la foi, pour le communiquer à tout homme. C’est le 2nd aspect de la foi, comme démarche intérieure d’accueil de ce Dieu qui vient à moi. Le défenseur de la foi se trouve alors démuni, se situant à l’extérieur. C’est Jésus qui frappe à la porte, et qui entre, seul. Mais Jésus envoie ses disciples en avant de lui, dans les lieux où lui-même devait aller. Mission d’aller préparer les cœurs, pour que Jésus puisse venir célébrer la Pâque dans le cœur de tout un chacun. La conviction de Saint Thomas d’Aquin est que la puissance de Dieu se manifeste dans sa générosité. Dieu suscite dans ses enfants une capacité d’agir les uns sur les autres. A la différence des puissants de ce monde, Dieu n’a pas besoin de se prouver qu’il existe en abaissant les autres. Au contraire, il associe ses créatures à son propre gouvernement de l’univers. A la fin de la prima pars, St Thomas envisage les différentes manières dont Dieu agit : Dieu seul est présent, agissant au plus intime de moi-même, au cœur même de mon activité la plus personnelle. L’altérité de Dieu n’est pas du même ordre que l’altérité humaine, en vis-à-vis d’autrui. Dieu est la source permanente de l’acte d’être qui me fait ce que je suis, et qui rend réelle toute activité positive. Deus intimior intimo meo. Le christianisme a ainsi sanctuarisé la personne. L’ordination de la personne à Dieu relativise toutes les relations horizontales aux créatures. Aucune créature n’a prise directe sur l’intimité de ma vie, l’action d’une créature ne passe que par les conditions extérieures de ma vie. Ainsi l’ange ne peut pas agir directement sur ma liberté ou mon intelligence, mais indirectement, sur les processus psycho somatiques qui conditionnent la vie de l’esprit. Pour l’homme, l’influence est encore plus limitée, même à son plus haut, qu’est l’éducation. Le maître ne communique pas sa pensée, mais manipule des idées, des mots, pour mettre son élève sur la piste. La lumière de la connaissance si elle agit, surgit de l’intérieur. Aucune créature ne peut donner la foi à une autre créature. L’acte de foi est un acte vital qui surgit de l’intérieur de la créature. Seul le Christ, le maître intérieur peut donner aux paroles extérieures une force de vie. Mais le maître extérieur doit établir des ponts entre l’univers mental de son interlocuteur et la vérité de la foi. Il a souci de rendre audible la parole de la foi. Il doit comprendre le contexte culturel de son interlocuteur, en discernant ce contexte facilite ou rend plus difficile la foi. L’incroyance contemporaine, n’est pas réductible à la seule mauvaise volonté. Elle est induite par un contexte culturel, intellectuel, qui rend la foi improbable, qui ferme l’accès à la foi : conception négative d’une liberté absolue déconnectée de la vérité, la mythologie de l’évolutionnisme, la réduction de la rationalité aux seules sciences dures aboutissant au relativisme, à l’abandon de la foi aux fluctuations du sentiment… Mon attention à la pensée médiévale est liée au souci de détecter à leur source des aiguillages défavorables à l’accueil de la foi.
Le combat de la foi est inséparable d’un certain style, avec une cohérence entre le contenu du message et la manière de l’annoncer. Appuyé sur la seule grâce du Christ, face au catharisme, Dominique a fait un choix décisif : la parole plutôt que les armes de la croisade. Comme David refusant l’armure de Saül, pour ne prendre que 5 galets, les 5 livres de la torah. Des formes plus subtiles de violence, pression sociale, chantage affectif, savoir institué, sagesse illusoire… Saint Paul y a renoncé, comme à toute forme de puissance autre que la vérité et la charité. La foi chrétienne n’a pas besoin d’autres armes. Elle s’appuie sur une cinquième colonne, un allié inviscéré dans le tréfonds de l’esprit humain : le désir de la vérité. Nous n’avons pas à le susciter : l’esprit est fait pour la vérité. La vérité ne s’impose alors que par la force de la vérité elle-même. C’est une reconnaissance qui s’opère dans l’acte de foi. Tu étais là et je ne le savais pas. La vérité doit être cherchée selon la manière propre de l’esprit humain, librement, par l’échange et le dialogue, où l’on s’expose la vérité que l’on a trouvé ou pense avoir trouvé. Manuel II paléologue, l’empereur byzantin, le disait : ne pas agir selon la raison, est contraire à la foi. On ne doit jamais recourir à la violence pour convaincre. Certes, les chrétiens n’ont pas toujours été à la hauteur de cette exigence. Jean-Paul II en a demandé pardon, pour le consentement à l’intolérance et la violence dans le service de la vérité.
Une légende veut qu’une nuit, Saint Dominique eut la visite de Pierre et Paul, qui lui remettent le bâton de pèlerin et le livre de l’Evangile. Les peintres ont doté les apôtres de leurs attributs habituels : les clés, et l’épée. Cette épée correspond à l’évangile lui-même remis à Dominique. La Parole de Dieu est cette épée à double tranchant qui sort de la bouche du Christ, qu’il n’aurait pour rien au monde échangée contre les rapières émoussées. Seule cette épée de la Parole aiguisée par la méditation et l’étude pourra infliger une blessure qui guérit toute blessure.
Concélébrer entre catholiques et orthodoxes
Le propos de la leçon est de savoir si dans l’état actuel des relations œcuméniques entre catholiques et orthodoxes, la concélébration eucharistique est possible ou non.
La pertinence ou non de cette concélébration, en raison de l’unité substantielle de foi dans le mystère eucharistique entre nos confessions, ainsi que sur le ministère ordonné. Pour le dialogue avec les protestants, la question est infiniment plus complexe. Il reste du chemin vers la pleine communion entre catholiques et orthodoxes, avec notamment la question du ministère du successeur de Pierre, et 1000 ans de séparation culturelle. La concélébration eucharistique, d’un point de vue purement dogmatique. Il y a 40 ans, nous étions très proches de voir Paul VI et Athénagoras concélébrer. Avec les 50 ans de Vatican II, la question mérite d’être reposée. Qu’est-ce qui à cette époque nous avait tant rapprochés ? Qu’est-ce qui nous a éloignés ?
Avec Vatican II la perspective était de partir de ce qui nous éloignait. Avec Vatican II, changement de perspective, en insistant sur ce qui nous unit à nos frères séparés. La question de la concélébration se pose ainsi : est-ce que la concélébration demande que l’on soit dans la pleine unité préalable, et la célébration manifesterait cette unité ? ou est-ce que l’unité requise pourrait être réelle, mais incomplète, et la célébration aiderait à compléter cette unité ? Avec les orthodoxes, la proximité est telle qu’il y a bien peu de différence qui fasse obstacle à la concélébration.
Pour les personnes individuelles, avant de parler de la discipline concernant les communautés, le mot discipline renvoyant au « comment être de vrais disciples », nous avons radicalement changé de manière de faire avec Vatican II. La discipline antérieure interdisait aux catholiques d’assister ou de quelque manière que ce soit à une célébration non catholique, du fait que cette participation aurait impliqué l’approbation aux croyances des cultes dissidents. Aujourd’hui, dans la discipline actuelle pour des personnes individuelles, si un catholique se trouve en pays orthodoxe, sans possibilité de participer à un culte catholique, il peut légitimement demander de participer à un culte orthodoxe, avec l’autorisation des responsables orthodoxes. La réciproque est possible : l’admission d’un orthodoxe à une célébration eucharistique catholique. Mais il y a d’autres éléments de cette discipline individuelle qui peuvent s’appliquer à des communautés : « nécessité impérieuse » et « bien spirituel ». Dans un contexte de crise générale de la mondialisation, n’y aurait-il pas lieu de manifester la fécondité d’une autre mondialisation en Christ ? L’Eucharistie pourrait-elle être en un moyen ? En évitant l’indifférentisme… Or la discipline actuelle reste très claire et très ferme, commune aux catholiques et orthodoxes : la concélébration par des ministres catholiques et orthodoxes, ne sera possible qu’après une entière et complète communion.
L’argument majeur est que l’Eucharistie est le sacrement de l’unité, à condition que l’on soit dans l’unité des moyens de grâce. Concélébrer l’Eucharistie alors que l’on ne serait pas dans cette communion préalable, serait un signe menteur, la perversion du signe sacramentel par excellence, un sacrilège. Cela est rappelé par les 2 confessions. Il ne s’agit pas d’introduire une rupture dans une tradition constante, mais on peut proposer une intelligence plus profonde des principes de cette tradition.
Par exemple, la doctrine des limbes, très largement commune a été l’expression de l’intelligence que l’on avait de 2 principes valables : le péché originel qui empêche d’entrer dans la béatitude, l’absence de péché personnel des enfants qui interdit leur damnation. Aujourd’hui, on cherche quels pourraient être les moyens pour les enfants en bas âge d’être reliés au Christ.
Est-ce que si l’on revisite ce qui nous unit, peut-on modifier le curseur en proposant une nouvelle pratique à partir d’une nouvelle interprétation des mêmes principes ?
La nature du mouvement œcuménique, des relations entre nous… La distinction de 2 œcuménismes, celui spirituel, et celui doctrinal. Le 1er est fondé sur les biens spirituels que nous partageons et pouvons vivre en commun. Cet œcuménisme est l’âme de tout œcuménisme, qui permet de célébrer ensemble la liturgie des heures. Le 2ème, doctrinal est second. L’œcuménisme spirituel n’a peut-être pas été assez sondé, avec la concélébration eucharistique comme préalable à la pleine unité dans l’œcuménisme doctrinal, actuellement en panne avec les orthodoxes.
La discipline actuelle qui prohibe s’il n’y a pas d’unité doctrinale complète, crée une situation paradoxale. La concélébration comme signe menteur, serait dépourvue d’effets de grâce, alors que la célébration séparée porterait des fruits de grâce. Peut-on essayer une 3ème possibilité ? la concélébration comme signe vrai d’une unité célébrée, pour parvenir à l’unité complète, mettrait en avant l’œcuménisme spirituel avant l’œcuménisme doctrinal.
La question la plus visible du dialogue catholique-orthodoxe, porte sur le ministère de l’évêque de Rome, qui pour les catholiques n’est pas seulement signe, mais cause d’unité dans l’Eglise, ce qui suppose une autorité, un certain pouvoir. Les orthodoxes n’y voient qu’une primauté d’honneur, un pur signe, sans la responsabilité de l’unité avec l’autorité nécessaire. Il est bon d’user des règles d’exégèse de Saint Thomas d’Aquin dans son « contre l’erreur des grecs », appelant à recourir aux mêmes autorités que celles des grecs, aux plus anciennes, même si elles sont moins explicites, en usant du sens des mots de nos interlocuteurs.
La primauté d’honneur, n’est pas vanité, symbole vide de tout sens. Honneur suppose dignité, renvoyant à l’autorité de Dieu. Personne ne doute que si une concélébration eucharistique avait lieu au plus haut niveau ecclésial, ce serait l’évêque de Rome qui la présiderait, exerçant une primauté d’honneur qui ne serait pas un symbole vide. Le 25 juillet 1965, Athénagoras accueille Paul VI, en le désignant comme « le premier en honneur entre nous, celui qui préside dans et par la charité », induisant sa présence à la présidence du sacrement de la charité. L’honneur rendu à l’évêque de Rome ne serait pas rendu à lui, mais au Christ, dans un rôle iconique. La divergence sur le mystère de la primauté, pourrait ne pas être aussi profonde qu’on le pense, en lui donnant un sens qui est celui le plus ancien et qui pourrait se manifester à sa juste place, avant toute définition canonique : rendre un honneur liturgique est beaucoup plus lourd de conséquences qu’on l’imagine. L’excellence personnelle de l’évêque de Rome reconnue dans l’Eucharistie impliquerait son autorité y compris dans le domaine de l’enseignement.
En changeant de discipline, on peut ne pas rompre avec la doctrine passée. Concélébrer le sacrement de l’unité pour que le signe ne soit pas menteur, suppose que l’on soit uni dans le mystère premier de la foi, et dans le mystère des sacrements qui portent le mystère premier. Une unité est requise pour la concélébration, qui pourrait être incomplète, et le dynamisme de l’unité pourrait être appuyé par la concélébration eucharistique.
Dans une partie de Ep 4, qui est un très grand chapitre pour saisir ce qu’est l’unité des chrétiens, Saint Paul dit qu’avec grande humilité et mansuétude, vous supportant avec patience et dans la charité, appliquez-vous à l’unité dans la paix. En évitant 4 risques et en cultivant 4 vertus : (1) fuir l’orgueil et cultiver l’humilité ; quand un orgueilleux veut présider d’autres orgueilleux, la dissension et la ruine arrivent. Il faut de l’humilité pour les conjurer. La dissension catholique-orthodoxe ne pourra être résolue par l’humilité intérieure et extérieure, qui introduit l’Eucharistie. (2) fuir la colère et cultiver la mansuétude ; chaque Eglise doit faire preuve vis-à-vis de l’autre de mansuétude. Ce fut le cas le 7 décembre 1965 lors de la levée réciproque des excommunications. (3) fuir l’impatience et cultiver la patience envers les opposants. Nous sommes encore opposants sur des points doctrinaux non mineurs. La patience est ici une attitude éminemment positive. (4) se méfier du zèle désordonné et pratiquer une endurance charitable. Ceux qui jugent imprudemment perturbent les communautés. Il faut pratiquer la charité, ce qui en contexte œcuménique que chacun supporte les manques de l’autre, laissant la charité œuvrer par la réconciliation via l’œcuménisme spirituel.
Si cet œcuménisme spirituel est l’âme de l’œcuménisme doctrinal, la concélébration œcuménisme ne pourrait –elle pas être le signe de ce primat ?